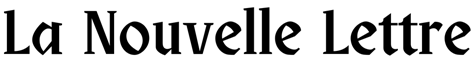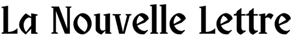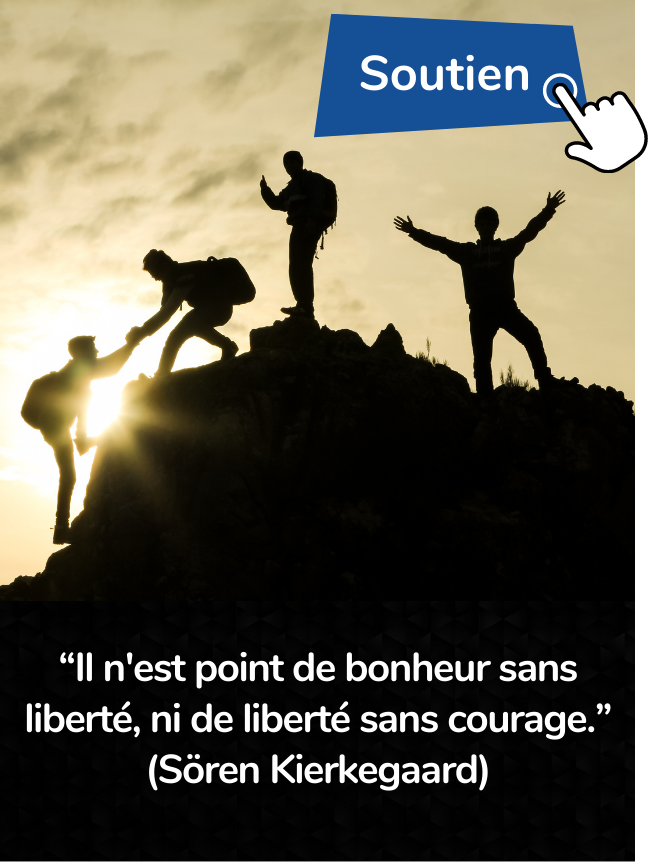En juin, un accord a été trouvé entre les États membres et le Parlement européen sur un « cadre commun » de règles pour fixer le salaire minimum dans les États membres européens. A l’exception de six pays qui conserveront leur système de négociation collective (Autriche, Chypre, Danemark, Finlande, Italie et Suède), les vingt-et-un autres devront faire appliquer par leur parlement national le nouveau cadre qui prévoit notamment que le salaire minimum national doit être égal à 60% du salaire médian (ou 50% du salaire moyen). Bien que les règles ne soient pas contraignantes, certains craignent que l’effort soit contre-productif et qu’il conduise à une plus grande centralisation en Europe.
Normes « décentes »
La notion de « salaire équitable » existe depuis la charte des droits des travailleurs de 1989 et est censée assurer un « niveau de vie décent ». La question des « travailleurs pauvres » est ici cruciale. Certaines personnes cumulent souvent plusieurs emplois pour – à peine – pouvoir payer leurs factures. Outre l’instabilité de l’emploi, leur pouvoir d’achat limité est une préoccupation légitime. D’où la stratégie consistant à trouver un niveau de revenu « adéquat » par la fixation d’un salaire minimum, tout en le liant aux performances salariales nationales (plutôt qu’un simple salaire minimum européen).
Comme l’a montré l’analyse économique cependant, un salaire minimum élevé (supérieur à 50 % du salaire médian national par exemple) peut engendrer du chômage, et même en fait réduire les revenus des populations peu qualifiées, avec moins d’heures travaillées, en particulier les jeunes (dont le taux de chômage est déjà de 13,9 % en Europe, mais atteint 29 % en Espagne ou 31 % en Grèce). En toute logique, le salaire ne devrait pas être supérieur à la valeur produite par le salarié pour l’entreprise pour que l’embauche ait un sens. Nombreux économistes pensent donc que pour assurer un niveau de vie décent, l’État devrait, à court terme, utiliser la politique budgétaire pour compenser les bas salaires versés par les entreprises, évitant ainsi de créer des distorsions dans le système des prix par des réglementations. Une perspective à plus long terme insiste en outre sur l’amélioration de l’environnement des affaires pour générer de meilleurs emplois, et plus nombreux.
Par ailleurs, le concept de niveau de vie devrait ici précisément prendre en compte les revenus nets, c’est-à-dire incluant la fiscalité (en moins) et les prestations sociales (en plus). Nous vivons bien sûr dans des sociétés d’État-providence dans lesquelles les niveaux et la structure de la fiscalité varient considérablement, tout comme les niveaux et la structure des prestations sociales. Certains pays peuvent avoir un système d’imposition plus progressif, d’autres ont des droits généreux en fonction de la catégorie de population à laquelle on appartient, et ainsi de suite. Dans ce contexte, la règle des « 60 % du salaire médian » parait donc une norme… arbitraire.
L’inflation
Évidemment, bien que la proposition soit dans les tuyaux depuis au moins trois ans, l’inflation actuelle en Europe fournit une nouvelle justification de cette évolution vers des salaires minimums plus élevés. Des denrées alimentaires de base à l’énergie, les prix ont augmenté de façon spectaculaire sur la dernière année (avec une augmentation annuelle de 8,6 % de l’indice harmonisé des prix à la consommation dans la zone euro en juin). En raison de la hausse des prix, les travailleurs les plus pauvres ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, d’où la nécessité de protéger leur pouvoir d’achat par de nouvelles réglementations salariales.
Cependant, comme des salaires plus élevés signifient des coûts plus élevés, les entreprises répercuteront ces augmentations sur leurs propres prix, alimentant ainsi l’inflation, et les travailleurs risquent de perdre leur pouvoir d’achat. Il s’agit en fait du même dilemme qu’avec une indexation plus large des salaires sur l’inflation, même s’il est vrai qu’il est moins généralisé. Une autre solution aurait pu consister à réduire de façon permanente les taux de TVA ou d’autres impôts indirects pour rendre les biens moins chers. Une telle stratégie renverse bien sûr la charge de la lutte contre l’inflation sur les épaules des États, mais cela pourrait être une bonne occasion de réformer les bureaucraties publiques et les nombreux « droits à », afin de mieux dépenser et donc de réduire les impôts.
Le dumping social
Une autre justification à cette réglementation du salaire minimum à l’échelle de l’UE est le « dumping social » des travailleurs à bas salaires des pays d’Europe de l’Est, dans le contexte du marché unique européen. Cet argument a par exemple été avancé par Clément Beaune, alors vice-ministre français des Affaires européennes, en juin 2022. Deux problèmes semblent inquiéter les décideurs politiques.
Premièrement, les salaires plus bas donneraient aux Bulgares, aux Roumains, etc. un avantage concurrentiel « injuste » par rapport aux Français, aux Néerlandais, etc. et contribuent ainsi à la délocalisation de l’activité industrielle vers l’Est et à la désindustrialisation à l’Ouest. L’idée est donc d’augmenter au moins les salaires à l’Est par le biais d’un salaire minimum plus strict, plus élevé, fixant des règles comparables à celles des pays plus riches.
Certains observateurs notent que malgré les apparences de « justice sociale », l’argument n’est qu’un recyclage de thèses protectionnistes et nuit à l’avantage concurrentiel de ces travailleurs. Et il va à nouveau à l’encontre de la logique du marché unique. L’argument est même quelque peu bizarre pour les pays occidentaux où des métiers manquent réellement de main-d’œuvre, soit en raison de politiques éducatives qui forcent les jeunes à obtenir des diplômes universitaires dévalués au lieu de promouvoir de manière productive la formation professionnelle (France), soit pour des raisons démographiques. (Certains pourraient dire qu’avec ce raisonnement, la riche Suisse, par exemple, devrait essayer d’inciter à une augmentation des salaires minimaux en France, car les travailleurs français « plus pauvres » font une concurrence déloyale aux Suisses dans les cantons francophones…).
Arguments moyens
L’un des problèmes de l’indexation du salaire minimum sur le salaire médian national, en particulier à 60 %, est que si l’économie, par exemple, a besoin de plus d’emplois hautement spécialisés (ingénieurs de haute technologie, etc.) avec des salaires élevés dans les grandes entreprises qui réussissent – faisant ainsi grimper le salaire médian – le salaire minimum national augmentera. Cependant, les petites entreprises qui comptent une bonne partie des travailleurs au salaire minimum supporteront l’essentiel du coût, ce qui nuira à leur rentabilité, et donc à leur incitation à investir et à embaucher.
En outre, la question doit être examinée également d’un point de vue territorial. Un pays n’est pas un « territoire économique » monolithique avec un niveau de développement homogène. Au contraire, il est composé de différents « territoires économiques » aux niveaux de développement hétérogènes. Si certaines régions bénéficient d’une croissance économique, ce qui fait augmenter le salaire médian national, cela signifie que les entreprises des régions plus pauvres qui ne bénéficient pas d’une croissance économique aussi forte devront payer des salaires minimums plus élevés, même si leurs bénéfices n’ont pas augmenté, ce qui pourrait accroître le chômage. (Les critiques pourraient répondre que cela ferait automatiquement baisser le salaire médian national, mais ce n’est pas le cas puisque les personnes sans emploi, qui ne gagnent pas de salaire, n’affectent pas le salaire médian.)
Ce processus peut en fait entraîner un effet de polarisation : les entreprises des régions plus pauvres des économies émergentes de l’Est auront de plus en plus de mal à rester rentables. Cela engendrerait davantage de chômage et donc de pauvreté, ainsi que des déséquilibres territoriaux. La réglementation sur le salaire minimum serait sans doute contournée par le travail au noir, mais certains travailleurs sans emploi et pauvres migreront vers des territoires économiques plus riches et plus dynamiques, ce qui y augmentera l’ « effet d’agglomération ». À condition toutefois qu’ils puissent trouver un logement décent. Car le problème dans certaines parties de l’Europe est le niveau accru de réglementation foncière qui rend la recherche et le paiement d’un logement très compliqués et coûteux. Et en fait, une façon sérieuse d’augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs serait d’assouplir ces réglementations afin d’augmenter l’accès au logement et d’en réduire le coût.
Une Europe francisée ?
De nombreux analystes considèrent que la référence de 60 % du salaire médian national est assez élevée. Les experts des pays de l’Est la fixent plutôt à 40 % pour être praticable. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si cet accord (tout comme plusieurs autres tels que la loi sur le marché numérique, la loi sur les services numériques ou la directive sur la due diligence) a été finalisé pendant la présidence française de l’Union. Le salaire minimum français s’élève en effet à 61 % du salaire médian – le deuxième plus élevé d’Europe.
Or, l’expérience française avec un salaire minimum aussi élevé n’est pas exactement une réussite. Le taux de chômage français n’a jamais été inférieur à 7 % au cours des 30 dernières années, et la plupart du temps autour de 9 %. Les salaires ont tendance à graviter juste au-dessus du salaire minimum. Le salaire minimum étant en réalité trop élevé, les emplois dont le salaire va jusqu’à 1,6 SMIC sont partiellement exonérés de charges sociales (pour compenser le coût pour les entreprises), ce qui incite les entreprises à rester sous le seuil. Cependant, cela a un impact sur la productivité des travailleurs qui ont le moins de chances de gagner plus, et entraîne au passage des problèmes de financement du système de sécurité sociale.
On a l’impression que les Français ont essayé d’imposer leur modèle social centralisé en Europe. Le problème n’est pas seulement qu’il n’est pas efficace, mais qu’il est loin d’être démocratique ou « social ». Il a en effet abouti à ce que seulement 7 % de la main-d’œuvre française est syndiquée, et principalement dans le secteur public. Dans un tel contexte, il n’existe pas de partenaires sociaux légitimes au niveau national, mais les syndicats sont néanmoins subventionnés par l’argent des contribuables et jouissent d’un pouvoir asymétrique puisqu’ils bloquent régulièrement le pays (pour rappel, les fonctionnaires bénéficient d’un emploi à vie, de droits syndicaux et du droit de grève, ce qui constitue une énigme démocratique – puisque les fonctionnaires sont censés travailler pour « le peuple », pas « un patron »). Quoi qu’il en soit, les négociations « décentralisées » entre partenaires sociaux sur les salaires minimums en fonction des branches et des territoires, ne peuvent se faire dans ce contexte.
Dynamique interventionniste
Il n’est pas étonnant que des pays comme la Suède ou le Danemark aient rejeté l’idée d’indexer un salaire minimum national sur le salaire médian, car ils veulent conserver leur système traditionnel « ascendant » de négociation collective des salaires entre les représentants des employés et des employeurs. Il est clair que le modèle danois ou suédois fondé sur la subsidiarité et la responsabilité est incompatible avec le modèle « social » centralisé français qui, malgré ses défauts évidents, semble gagner du terrain en Europe.
Dans cette perspective, certains observateurs conservateurs et libéraux craignent que cette initiative sur le salaire minimum ne soit qu’un début. Le projet européen est en réalité en train de déployer des forces croissantes de centralisation, contre la subsidiarité et la concurrence institutionnelle. En imposant progressivement des règles de fixation du salaire minimum, il semble évident que, comme nous l’avons noté plus haut, la diversité des systèmes fiscaux et des droits sociaux finira par poser problème. Ce sera alors une justification pour une dynamique d’intervention avec une harmonisation de ces systèmes également, et un grand pas en avant vers la centralisation en Europe.
Une version de cet article d’Emmanuel Martin a été précédemment publiée en anglais par GIS reports, disponible ici.